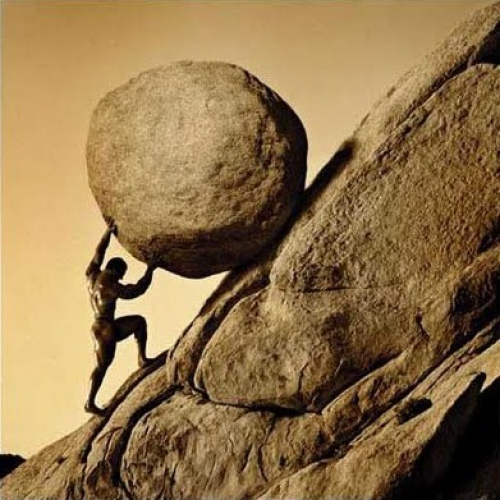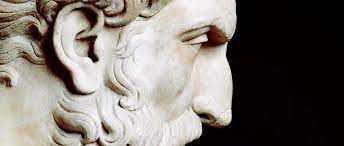Accueil » Philosophie pratique » Page 3
La multiplication des épisodes électoraux a conféré au mot « abstention » une sorte d’exclusivité politique. Or le terme en lui-même et sa famille ont une portée beaucoup plus large, qu’il vaut la peine de considérer. Son étymologie latine, le verbe abstinere – abs, « hors de » et tenere, « tenir » –, signifie « tenir éloigné ». Dans un article centré sur l’abstention politique[1], Denis Barbet, maître de conférences en science politique à l’IEP de Lyon, retrace l’évolution du terme au…
« Le dur métier de vivre » est le titre d’une eau-forte du peintre Georges Rouault, au style pictural très particulier, rappelant qu’il a été au départ l’apprenti d’un peintre de vitraux. L’œuvre figure, en noir sur blanc, un homme nu, les yeux fermés, la nuque courbée comme si pesait sur elle tout le poids du monde. Pour Rouault, si la vie est dure, c’est, écrit-il, qu’elle est sous-tendue par la tromperie : « Nous ne sommes que mensonge,…
Les censeurs s’insurgent : la tortue namuroise doit rentrer sous terre. La récente condamnation, en première instance, de Jan Fabre, pour « des faits de violence, de harcèlement et de comportement sexuel inapproprié » a relancé un débat récurrent : faut-il associer ou dissocier un auteur et son œuvre ? Un artiste jugé coupable – quelle que soit la nature de ses délits – doit-il renoncer à son art, puisque toutes ses œuvres à venir ne peuvent être réalisées que…
Un potentat russe fait redécouvrir au monde entier les affres de la barbarie érigée en système d’État. Ce déni d’humanité révolte au point de faire ressentir son auteur comme étranger à l’espèce humaine. Il est vrai qu’une telle démesure dans l’inhumanité reste l’exception. Mais, à une autre échelle, des barbaries plus ordinaires existent et ont tendance à se banaliser. Il y a quelques jours, piéton, j’attendais le feu vert pour traverser. En face, un excité…
La langue latine ne désarme pas. Peu à peu minorée, voire marginalisée dans l’enseignement, elle reste en embuscade dans notre quotidien et ressurgit par plus d’un détour. Elle a réussi un récent coup d’éclat avec le mot de l’année 2021 choisi par les internautes du Soir et de la RTBF : ultracrépidarianisme. Apparu dans sa version anglaise – ultracrepidarianism – dès 1819, le mot n’a connu sa graphie française qu’il y a peu, en 2014. L’ultracrépidarianisme…
Depuis quelques années, l’expression « fake news » a proliféré dans l’espace public – en particulier dans les médias – avec la même combativité que l’anglais lui-même et son expansionnisme tentaculaire. Or, son apparition n’est pas toute récente. Selon Jayson Harsin, professeur à l’université américaine de Paris, le terme fake news aurait été utilisé pour la première fois en 1999, lors de l’émission de télévision satirique américaine The Daily Show. D’emblée les francophones qui continuent à parler…
Au rayon des mots nouveaux agréés par les dictionnaires, la pandémie a la partie belle : les apocopes corona et réa, coronapiste, « piste cyclable provisoire née du déconfinement pour favoriser la pratique du vélo en ville », arrivent en tête de liste. Pour contourner les obsessions du moment, oserais-je une autre proposition en vue du recensement de 2023 ? Je suis tenté par un verbe d’inspiration mythologique : « pygmalier ». Dans la mythologie grecque, Pygmalion, sculpteur chypriote descendant d’Athéna…
(version intégrale) Après des siècles de cohabitation, le moment est-il venu de placardiser les penseurs anciens ? Et avec eux le grec et le latin qui donnent accès à leur lecture dans le texte même ? L’éducation, qui se veut moderne et numérique, y gagnerait-elle ? Ou, au contraire, se saignerait-elle ipso facto – et à tort – d’une part importante de son humanisme, sinon de son humanité ? Fervent supporter de l’Antiquité grecque, je reste stupéfait de vérifier…
(version abrégée) Faut-il placardiser les penseurs anciens et, avec eux, le grec et le latin, accès directs à leur lecture ? Une éducation qui se veut moderne et numérique y gagnerait-elle ? Ou, au contraire, se saignerait-elle ipso facto d’une part notable de son humanisme, sinon de son humanité ? Ces échos intemporels, chaque époque les entend de sa propre oreille. À condition qu’une écoute attentive évite les simplismes. Un exemple type ? Épicure, associé sans nuances à la…
Une enquête récente pose la question : « Bye bye la démocratie ? » Elle débouche sur un constat : la confiance s’est érodée. Pour 60 % des sondés, les politiques ne sont plus à même de changer quoi que ce soit au quotidien. Un répondant sur trois – un sur deux dans la fourchette des 25-34 ans – juge que le pouvoir serait mieux exercé par un seul leader que par un régime parlementaire. Si la démocratie représentative semble en…