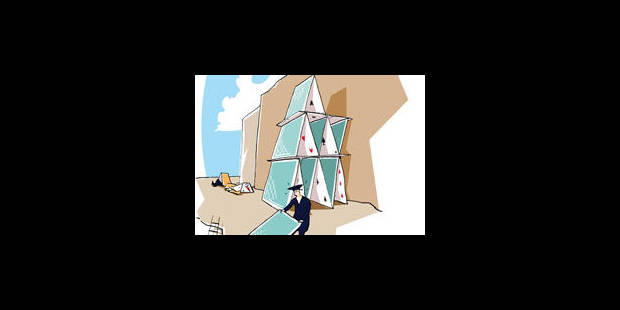Une première année dans l’enseignement supérieur n’a rien d’une sinécure. La plupart des étudiants le confirmeront sans se faire prier, surtout en période de « bloque ». Mais travailler dur – ou avoir la conviction qu’on travaille dur – ne suffit sans doute pas à la réussite. Les statistiques révèlent l’ampleur des échecs : qu’il s’agisse du supérieur universitaire ou non universitaire, de type long ou court, avec de légères fluctuations dans le temps, bon an mal an, le taux de réussite en première année flirte avec les 40 %. Ce constat choquant en incite plus d’un à mettre en cause, sans nuances, la qualité de l’enseignement qui a précédé, maternel, primaire et secondaire. Sans vouloir materner l’enseignement, disons que ce raccourci est quelque peu primaire : même si des prérequis substantiels en matière de savoirs et de compétences sont bien sûr indispensables, ils pourraient n’avoir qu’un impact secondaire par rapport à d’autres facteurs qui entrent en jeu.
Des statistiques plus complètes, qui, à ma connaissance, ne sont pas disponibles, pourraient, par exemple, nous indiquer le taux de réussite des étudiants qui ont réellement présenté les examens. Je veux dire par là « qui ont présenté les examens après avoir tout fait pour les préparer au mieux et en comptant fermement les réussir ». Car dans les faits, on découvre un écart impressionnant entre le nombre d’étudiants inscrits en septembre et celui des étudiants réellement et totalement présents aux examens. Pour les autres, qui ont abandonné – la démission peut prendre diverses formes –, que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui a joué ? Avaient-ils nécessairement, en fin de secondaire, des résultats inférieurs à ceux des étudiants qui ont réussi ? Ce n’est pas sûr. Pour bon nombre d’entre eux, comme d’ailleurs pour certains tâcherons jusqu’au-boutistes, l’échec s’explique par l’inadaptation à un autre style de travail intellectuel et à un autre style de vie que ceux qu’ils ont connus jusque-là.
Or, reconnaissons-le, le régime de vie actuel, hors de l’école mais forcément aussi dans l’école, est loin de n’avoir que des incidences positives sur cette adaptation nécessaire. Un premier trait saillant surgit à l’évidence : nous vivons dans un univers qui privilégie la quantité par rapport à la qualité ; d’où le libre cours donné à la précipitation, à la dispersion, à l’approximation. La vitesse d’exécution devient un critère du bon fonctionnement des choses, tandis que la patience qui laisse au temps le temps de jouer n’est plus du tout à la mode.
Dans la vie quotidienne, un exemple saute aux yeux, celui de l’information. Combien de journalistes qui nous « informent » se soucient avant tout d’« être le premier sur la balle » : vite sortir le scoop plutôt que prendre le temps d’une analyse, ou seulement d’une vérification soigneuse. À partir de là, profusion d’images, de visions et de révisions, de redites, d’émissions spéciales organisées pour un oui ou un non. Avec, à la clef, des bavures nombreuses tant dans le fond que dans la forme. Autre exemple typique : l’enseignement lui-même, et particulièrement ses programmes, qui ont subi cette offensive de la quantité contre la qualité. Surenchère au nombre de matières que chaque élève va pouvoir caser dans sa « grille », plutôt que souci de consacrer assez de temps et d’attention à quelques matières fortes pour qu’elles en deviennent de véritables instruments de formation. Beaucoup et vite, plutôt que mesure et patience.
Un deuxième trait de notre univers quotidien est le primat accordé à l’instant sur la durée. Le court terme devient le seul horizon de combien d’activités dans lesquelles on s’engage résolument, mais qu’on déserte sans délais pour passer à autre chose. Comme si aller jusqu’au bout semblait désormais de l’ordre de l’irréaliste, voire du ringard… Et combien d’engagements, personnels, familiaux, professionnels, qui s’inscrivaient encore il y a pas si longtemps dans la durée, deviennent de plus en plus courts, fugaces, tributaires des circonstances et de l’instant ? L’occasionnel et le provisoire prennent le pas sur le stable et le définitif.
Celui qui sacrifierait à la quantité et à l’immédiateté serait tout à fait dans l’air du temps s’il se ralliait à une troisième tendance : préférer l’émotion à la raison. Cela s’avère en politique, où les responsables se précipitent sur les lieux dès qu’un fait divers émeut l’opinion et promettent de nouvelles lois branchées sur les désarrois ou les affolements du moment. Or, la politique raisonnable ne suppose-t-elle pas au contraire le recul patient qui fonde les décisions stables, posées, sensées ? C’est vrai aussi dans le quotidien, lorsque le critère principal pour s’adonner à une activité ou prendre un engagement n’est plus rien d’autre que le « j’aime » ou « je n’aime pas », le plaisir sensible immédiat.
Si cette analyse sommaire – et bien loin de faire le tour de la question – a quelque pertinence, elle suscite une inquiétude : quels types de réflexes et d’attitudes une telle façon de vivre enseigne-t-elle aux jeunes en formation ? Quelle influence exerce-t-elle sur eux dans la perspective du travail intellectuel qui les attend et du régime de vie qui le favorise ?
Plus que le secondaire, l’enseignement supérieur va demander d’approcher les matières en adoptant pour principes directeurs la qualité, la capacité d’aller avec patience jusqu’au bout des choses, et l’usage de la raison, qui ne gomme pas la dimension affective, mais la tempère. Et pour que le sérieux effort de travail soit vivable, l’étudiant a besoin d’une qualité et d’une hygiène de vie bien pensées, d’une détermination à aller jusqu’au bout de ses choix et d’une capacité à dépasser, ici et là, les « coups de blues » pour tenir des engagements à long terme. Impossible donc de le dire autrement : de ce point de vue, l’air du temps n’aide pas les jeunes et ne les amène pas « dans un fauteuil » aux portes des études supérieures.
Restons néanmoins résolument optimistes. Car le constat ouvre en même temps des voies pour une préparation à ces études qui soit de l’ordre du « savoir-être », autant sinon davantage que du savoir. Dans les pratiques de l’école comme dans la vie quotidienne des familles, toutes les occasions sont bonnes à saisir : « il suffit », chaque fois que possible, de rendre droit de cité à la qualité plutôt qu’à l’approximation, à la durée plutôt qu’à l’instant, à l’équilibre entre l’émotion et la raison. Ce sont les détails de vie, parfois infimes, mais choisis et voulus, qui construisent en fin de compte nos attitudes et nous façonnent tels que nous sommes. Pour changer des habitudes acquises, modifier avec patience détail après détail est plus efficace que de grandes résolutions aux lendemains incertains. Ce constat invite aussi les adultes que nous sommes à un regard sur nous-mêmes et nos propres attitudes. Car il est sûr que nous tous, parents et éducateurs, éduquons et formons bien plus par notre manière d’être que par nos propos sur l’éducation, par ce que nous faisons bien plus que par ce que nous disons. Seul l’exemple paie. Pour un adulte, la bonne façon d’assister un jeune dans sa préparation à l’enseignement supérieur, c’est de vivre à ses côtés une vie dans laquelle les valeurs qu’il souhaite promouvoir apparaissent, avec la force de l’évidence, présentes, motivantes, enthousiasmantes, et promesses d’avenir.
Publié dans La Libre Belgique, p. 54, le lundi 5 septembre 2011.