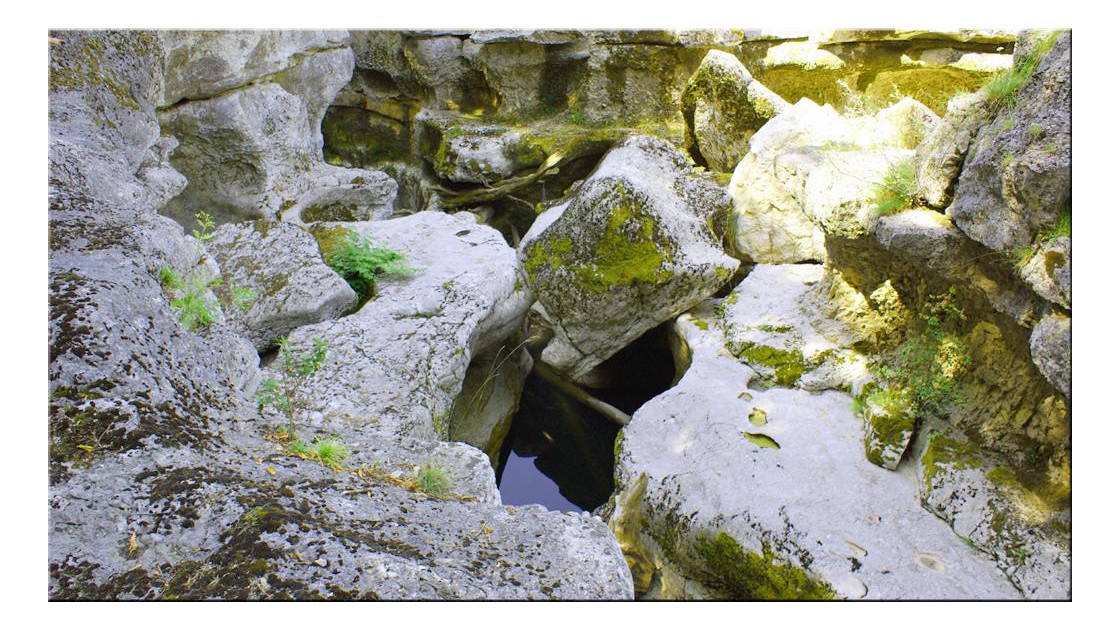Là où en est aujourd’hui l’État belge, où en est l’état de la démocratie ? Cahot, chaos ou K.-O. ? Soubresaut dû à un sol inégal, désordre épouvantable ou mise au tapis sous la rafale des coups ? Voyons un peu… Tous les régimes politiques peuvent connaître leur mauvaise passe, leur heure de doute. Comme n’importe quelle institution qui, par acharnement à appliquer jusqu’à l’extrême ses propres principes de fonctionnement, se découvrirait un beau (?) jour inapte à poursuivre son objectif, voire occupée à le mettre à mal. L’institution politique n’échappe pas à la règle.
Quand Aristote, au livre I de la Politique, catalogue les formes de gouvernement, il les accepte toutes – monarchie, aristocratie, république – comme justes, à condition que leur visée soit l’intérêt public. Si ces régimes en viennent à rechercher des intérêts personnels, il y a dérive : la tyrannie au profit exclusif du monarque, l’oligarchie à celui des riches, la démocratie à celui des pauvres. Tel est donc le cœur de l’activité politique juste : l’intérêt public. Car, ajoute-t-il, toute cité – tout État – est une communauté organisée en vue d’un bien.
La plupart de nos sociétés occidentales ont décidé que c’est la démocratie, si elle reste au service de tous, sans exclusive ni exclusion, qui offre le plus de chances d’avancer vers le bien commun. La définition et la réalisation de ce dernier ne vont pas de soi : elles constituent, au fond, le travail permanent, collectif et solidaire de tous les citoyens. Ceux-ci sont tous « militants et artisans du bien commun » à travers une diversité de rôles et d’actions, dont la fonction politique n’est qu’une variante : l’homme politique ne change pas de nature, mais reste, comme tous les autres, un citoyen actif, auquel d’autres citoyens actifs confient une charge politique particulière.
Dans la vie démocratique rêvée, il n’existe pas le moindre écart entre citoyenneté et fonction politique, entre citoyen et politicien. C’est alors que le bien commun passe dans la réalité : parce que chacun éprouve, face à lui, un sentiment de proximité, voire de familiarité, il en fait « son affaire » et contribue autant à le définir, à le peaufiner qu’à le réaliser une fois qu’il est défini.
Par rapport à cet état idéal, où se situe pour l’heure l’État Belgique ? En s’éternisant, la crise a amené nombre de citoyens – dont peut-être des politiciens – à une sorte de « désespoir démocratique ». En lieu et place de cette proximité vitale pour la démocratie s’est ouverte une ère de la déconnexion tous azimuts. Déconnexion d’abord entre le citoyen et ses représentants politiques, le premier ressentant que les seconds gravitent dans un autre univers, étranger et étrange, décalé : on négocie sans se réunir, on marche sur certains œufs tout en en piétinant d’autres, on rajoute une couche de difficultés dès qu’une avancée se dessine, on feint de chercher sans espérer trouver.
Déconnexion aussi entre l’électeur et l’élu, le premier surpris de voir celui qu’il a désigné pour l’action faire du sur-place sans vergogne pendant des mois comme si même l’action improductive suffisait à justifier des émoluments. Déconnexion encore entre les centres d’intérêt du commun des mortels et ceux des immortels de la politique, qui donnent quelquefois l’impression d’inventer des problèmes politiques pour avoir le plaisir de ne pas les résoudre. Mais déconnexion surtout, pourrait-on dire, entre l’objet fondamental de l’activité politique – le bien commun – et les objets de discussions classés incontournables.
Or, dirait Aristote, si l’activité politique ne s’exerce plus dans l’intérêt public, l’État, qu’il soit démocratique ou non, n’existe plus ou ne mérite plus son nom. Plus qu’un cahot, ou un chaos, ce serait donc bel et bien un K.-O. Qui est l’arbitre, en train de compter les secondes ? Les agences internationales de notation ou simplement le citoyen ? L’urgence est là. Aux « responsables » de retrouver leurs esprits pour que l’État reprenne conscience avant la limite fatidique.
Publié dans La Libre Belgique, p. 53, le mercredi 9 février 2011.